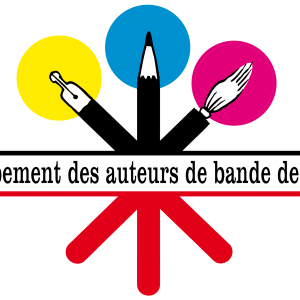Bulletin des auteurs – Quel est le rôle de l’Upad ?
Philippe Lebeau – L’Upad est la seule organisation dédiée exclusivement aux auteurs de doublage. Elle s’est créée voilà une petite dizaine d’années, à l’initiative de Vanessa Bertran, Jean-Louis Sarthou, Rebecca et Nicolas Mourguye, avec pour objectif de faire connaître les spécificités du métier d’auteur de doublage, auprès des auteurs eux-mêmes, et de leurs partenaires, ministères et organismes, et défendre les conditions d’accès du public à un doublage de qualité. Notre mission est de représenter et d’informer nos adhérent.e.s, tous membres ou sociétaires Sacem (qui gère les droits du doublage et du sous-titrage depuis l’époque du cinéma muet), sur les évolutions législatives et sociales. Nous avons été très présents dans le combat contre l’hégémonie des Gafam et pour la directive européenne sur le droit d’auteur. Notre travail est aussi pédagogique, nous participons à des forums, à des conférences, des séminaires de formation et des rencontres dans le cadre de festivals, et aux côtés de la Sacem. En janvier 2020, nous organisons, en partenariat avec l’université de Bourgogne, la première édition des « Rencontres des écritures créatives », autour du thème : Comment fabrique-t-on la bande-son d’un film ? Quel est le travail de postproduction que l’on peut faire sur un film ? avec des étudiants en master de traduction multimédia, qui vont inventer des dialogues, et des comédiens professionnels, qui vont venir jouer et enregistrer ces dialogues en public.
B. A. – En quoi consiste le métier du doublage ?
Ph. L. – L’écriture de doublage est un métier qui en regroupe plusieurs : fondamentalement, nous le considérons comme un métier de dialoguiste, plus que de traducteur. Si la traduction fait partie inhérente de la phase d’adaptation, le vrai enjeu est d’écrire des dialogues qui soient vivants, fidèles à l’esprit d’origine, qui soient rythmés et d’une clarté et d’une fluidité les plus grandes possible dans la langue cible, en l’occurrence le français. C’est un métier d’artisanat, passionnant, prenant, qui demande une grande curiosité pour les cultures du monde, et extrêmement enrichissant : chaque jour, en travaillant, nous nous documentons, nous apprenons. Étant par ailleurs acteur et lecteur public, je nourris de mon expérience de la scène mon travail d’adaptateur en injectant ma vision d’un dialogue vivant, parlé, plus que littéraire. Un peu comme Flaubert qui écrivait « au gueuloir », nous sommes amenés à jouer notre dialogue à voix haute, seul chez nous mais aussi parfois en présence du directeur de plateau, car notre écriture a cette particularité qu’elle n’est pas destinée à être lue, mais à être entendue, et donc jouée et interprétée par des comédiens qui ont besoin de « nourriture », de matière à mâcher, et surtout de sens, pour pouvoir rendre leur dialogue compréhensible. C’est la préoccupation constante que nous avons en tête : mon adaptation parvient-elle à rendre une idée claire, compréhensible ? Quel est le sens, réel ou caché, d’une phrase, d’une expression ? Que doit comprendre le spectateur ?
B. A. – La technique évolue-t-elle ?
Ph. L. – Autrefois nous écrivions avec un crayon sur une bande de plusieurs kilomètres de long, qu’ensuite nous devions rembobiner et rapporter à la société de doublage, qui la confiait à une calligraphe, laquelle recopiait ce que nous avions écrit mais sur un bobino transparent, et donc projetable, puis cette bobine allait à une autre personne, qui tapait à la machine le texte, pour aboutir à une édition écrite du texte et à une édition projetable de ce même texte, synchronisée avec l’image, afin que les comédiens puissent lire, exactement comme dans un karaoké. Aujourd’hui, la bande défile sur votre ordinateur, il est facile de repérer soi-même les ouvertures et fermetures de bouche et poser un magnifique « Tout mais pas ça » sur un « Oh my God », par exemple ! Le gain de temps est considérable. Nous n’avons plus à nous déplacer pour rapporter la bande, nous l’envoyons par mail. La chaîne de doublage s’en est trouvée fortement accélérée, ce qui coïncide avec l’arrivée de nouvelles plates-formes de diffusion imposant des délais de réalisation de plus en plus courts. Et beaucoup d’auteurs se sont découvert une nouvelle liberté, celle de pouvoir écrire en toute mobilité, par exemple.
B. A. – C’est alors un progrès ?
Ph. L. – Dans le sens où nous pouvons exercer notre métier sans contrainte géographique, oui, et de façon plus rapide et moins contraignante. On déplore surtout la disparition des métiers de calligraphes, de rédacteurs, qui ont dû se reconvertir, et la fragilisation du métier de détecteur. Pourtant, même si certains acteurs ou directeurs artistiques objectent que s’installe une certaine standardisation de la façon d’écrire, une rythmique moins lisible en raison de caractères dont on ne peut moduler la forme que de façon limitée, ou encore si certains auteurs fâchés avec l’informatique reprochent leur nouvelle dépendance technologique… personne ne souhaite revenir en arrière. Nous nous interrogeons aussi sur l’avenir d’un métier bien spécifique, celui de détecteur, c’est-à-dire la personne qui intervient avant l’écriture en procédant au repérage, dans le film, des endroits où la bouche de l’acteur s’ouvre, avance ou se ferme, un travail extrêmement minutieux qui nous guide et nous sert de marque lorsque nous posons notre texte : démarre-t-il sur une labiale ? Pourra-t-on vraiment traduire un « I can’t understand » dit par une bouche i-ouverte par « Je ne peux pas comprendre », où l’on ne compte pas moins de trois labiales bien visibles ?
Une part du combat mené par l’Upad consiste à valoriser ce métier technique, qui ne s’improvise pas, qui s’apprend et prend du temps. Or, avec le développement de l’informatique, de plus en plus de sociétés de doublage demandent à l’auteur des dialogues de prendre en charge, en sus de leur écriture, ce travail de détection. Ce peut même être une condition pour remporter un marché, comme si l’on proposait à un plombier de l’employer à condition qu’il se charge aussi de l’électricité, pour le même prix bien entendu, ou à peine plus. Or les détecteurs relèvent du régime des intermittents, ce qui n’est pas le cas de l’auteur, et leur travail prend un certain temps. Les auteurs acceptant de prendre en charge ce poste fondamental doivent aussi avoir conscience que leur rémunération relève en conséquence de deux régimes bien différents.
B. A. – Une même personne peut-elle être membre de l’Upad et de l’Ataa ?
Ph. L. – Rien ne s’y oppose. L’Ataa accueille aussi bien les auteurs de doublage que de sous-titrage. Même si cela reste assez marginal, certains auteurs pratiquent d’ailleurs les deux disciplines. De plus, auteurs de doublage et auteurs de sous-titres sont souvent amenés à collaborer, et à assurer une certaine cohérence entre VF et VOST sur des films ou séries plus prestigieux. L’Upad a choisi de prendre un nouveau départ cette année, en initiant un rapprochement entre elle et son organisation professionnelle sœur, l’Ataa, qui regroupe les traducteurs et adaptateurs de l’audiovisuel.
Des problématiques complexes, liées à la clé de répartition retenue pour ventiler les droits perçus par les uns et les autres en tenant compte des diffusions multilingues (VM), ont à l’époque généré un climat conflictuel entre nos deux organismes. Notre image à tous, vis-à-vis de la profession et de la Sacem, qui est notre maison commune de la gestion collective, en a beaucoup pâti. Il nous a semblé que l’élection de Vanessa Bertran, présidente de l’Upad, première auteure de doublage à siéger au conseil d’administration de la Sacem, était un signal fort pour amorcer une nouvelle ère dans nos rapports. Lors les journées de la création, cet été à Lyon, David Ribotti et moi, désireux de ne plus avoir à gérer des tensions nées il y a plus de dix ans, avons fait part à deux représentantes de l’Ataa de notre envie de rétablir, entre nos deux organisations, ce qui fait le cœur même de nos métiers d’auteurs plongés dans la tourmente : le dialogue.
Notre objectif ? Remettre une partie de nos forces en commun, sur des bases nouvelles et saines, afin de pouvoir avancer de manière concrète dans nos attentes vis-à-vis de la Sacem, et présenter un visage apaisé et mature de la profession en engageant plus judicieusement notre énergie sur des problèmes comme les retraites, la survie du droit d’auteur, la vraie prise en compte des problématiques respectives du sous-titrage et du doublage, et de la réelle menace qui pèse sur le droit d’auteur et sur le métier d’auteur en général, et son absence cruelle de statut.
Le rapprochement Ataa-Upad, favorisé par le Snac où se sont déroulés nos premiers échanges ouverts et constructifs depuis longtemps, se concrétisera notamment à la Sacem, lors d’une journée professionnelle commune, dont la dernière édition remonte à 2007, et où seront abordées des thématiques tournées non plus vers ce qu’ont été ou sont encore nos points de désaccord, mais vers ce que seront nos métiers demain, et quel rôle y joueront nos sociétés de gestion. Ces dernières sont collectives, c’est pourquoi nous misons sur l’intelligence collective et sur la faculté d’adaptation qui fait la singularité de nos métiers pour sortir l’auteur de son isolement et le mettre au cœur des combats et des évolutions à venir.
Photo : Philippe Lebeau – Crédit : Carole Cadinot
Cet entretien a paru dans le Bulletin n° 140, février 2020.